« Mon esprit inquiet ne supporterait jamais
De couver si longtemps une volupté,
S’il n’épiait, quoique craintivement
Une espérance derrière l’ombre d’un rêve. »
(Endymion)
Il a vingt trois ans lorsque parait « Endymion » en 1818, hors du cercle de ses amis, nul ne le connaît. Il n’a plus qu’à peine trois ans à vivre !...
John Keats vient au monde le 31 octobre 1795 dans la banlieue de Londres. Apprenti apothicaire à l’âge de quinze ans, à vingt ans il décide de se consacrer à la poésie.
Le comportement de Keats, tour à tour insolent ou intensément effacé de son identité, drapé dans la chair de ses mots est jugé sévèrement par la société puritaine d’alors.
(Les lecteurs se choqueront de ses lettres publiées en 1878.)
 Le 11 octobre 1818 il fait la connaissance de Fanny Brawne dont il s’éprend. Durant les deux années de cette passion, il va lui écrire trente sept lettres, tour à tour tendres, ardentes où le tourment amoureux qui l’assaille s’exprime avec le lyrisme fervent d’une âme exigeante qui alterne avec une sincérité bouleversante qui ne sait feindre.
Le 11 octobre 1818 il fait la connaissance de Fanny Brawne dont il s’éprend. Durant les deux années de cette passion, il va lui écrire trente sept lettres, tour à tour tendres, ardentes où le tourment amoureux qui l’assaille s’exprime avec le lyrisme fervent d’une âme exigeante qui alterne avec une sincérité bouleversante qui ne sait feindre.
Le 1er juillet 1819 :
« Dites, mon amour, s’il n’est pas très cruel à vous de m’avoir ainsi pris dans vos filets, d’avoir détruit ma liberté. L’avouerez-vous dans la lettre que vous devez sur – le – champ m’écrire et où vous devez par tous les moyens me consoler ; qu’elle soit aussi envoûtante qu’une bouffée de pavot et me fasse tourner la tête ; tracez les mots les plus doux et baisez-les que je puisse du moins peser mes lèvres là où les vôtres ont été… »
Le 8 juillet 1819 :
« Votre lettre m’a empli d’une joie immense, de celle que vous seule au monde êtes en mesure de me procurer ; je suis même presque stupéfait de constater l’emprise qu’une personne absente peut exercer sur mes sens. Lors même que je ne pense pas à vous, votre influence parvient jusqu’à moi et m’attendrit… !
Je n’ai jamais connu un amour de la sorte que vous m’avez fait connaître ; je n’y croyais pas ; mon imagination le redoutait, de peur d’être consumé. »
Keats sait son infortune et son mariage sans issue. Il travaille à sa poésie et ne leurre point Fanny.
« N’oubliez pas que je n’ai eu aucun loisir pour songer à vous, cela vaut peut-être mieux ainsi ; je n’aurais guère pu supporter la foule des jalousies qui m’assaillaient si profondément au cœur de mes préoccupations imaginaires »…
« Je survole des yeux cette page cruellement dépourvue de paroles galantes et courtoises ; je n’y peux rien, je ne suis ni préposé aux discours d’usage ni Roméo – prêcheur…
Pourtant, je vous en conjure, réfléchissez-y à deux fois et demandez-vous s’il ne vaut pas mieux que je vous expose mes sentiments plutôt que de vous témoigner une passion factice ; et puis vous me perceriez à jour, il serait vain de vouloir vous tromper…
Vous dites que je peux faire comme bon me semble… en mon âme et conscience, voilà qui me paraît impossible. Mes liquidités sont à cette heure taries, pour quelque temps, je le crains ; tout argent que je dépense ajoute à mes dettes. »
Vains efforts que de renoncer à celle qu’il aime et dont il est aimé, même si le doute l’effleure. Fanny a dix-huit ans, elle n’est pas exempte de coquetteries… ce dont il souffre cruellement.
Le 13 octobre 1819 il lui écrit :
« Je n’existe pas sans vous ; je suis oublieux de tout sauf du moment où je vous retrouverai ; ma vie semble s’interrompre net à cet endroit ; je ne vois pas plus loin. Vous m’occupez tout entier. J’ai présentement la sensation de disparaître ; je serais profondément malheureux sans l’espoir de vous revoir bientôt. Songer que je pourrais être loin de vous m’effraie. Fanny, ma douce, ton cœur changera – t – il jamais ? Mon amour, ce cœur changera – t – il ? J’éprouve en cet instant un amour sans borne ; votre billet vient tout juste d’arriver ; je ne peux être plus heureux loin de vous, cela est plus précieux qu’un galion de perles. Ne me menacez pas, même pour plaisanter… mon amour est égoïste ; sans toi je ne respire plus.
Tout à toi. »
John Keats possède un diplôme d’apothicaire, de médecin et de chirurgien, aussi est-il sans illusion sur le mal qui après avoir emporté sa mère et son frère Tom, va s’abattre sur lui. Dès le 18 août 1818, il commence à souffrir d’un mal de gorge. Le 3 février 1820, il prend froid et crache du sang. Il sait que c’est là le premier signe de son arrêt de mort.
Et même si l’aile de la mort porte sur lui son ombre funeste, jamais elle ne ternit le resplendissant éclat de la Nature, l’ourlet d’écume de la mer, le murmure des ruisseaux, les pétales des fleurs odorantes où s’abreuvent ses vers au vol rapide frémissant du malheur qu’il sait venir le frapper !
« Vous devez croire, vous le croirez, il le faut, que je ne puisse rien dire rien penser de vous qui n’ait sa source dans l’amour qui depuis si longtemps fait ma joie et mon tourment. Le soir où je tombais malade, où un afflux de sang se produisit dans mes poumons si violement que je faillis suffoquer – Je vous assure que j’entrevis la possibilité de ne pas y survivre et qu’en cet instant ma seule pensée fut pour vous… mais j’attends avec impatience le printemps ainsi que la régularité de nos anciennes promenades. »

Fanny Brawne refuse de rompre leurs fiançailles.
« Si je devais mourir, je n’aurais laissé aucune œuvre immortelle derrière moi ; rien dont le souvenir rendrait mes amis fiers ; pourtant j’ai révéré le principe de la beauté en toutes choses et, si j’en avais eu le temps, j’aurais fait en sorte qu’on se souvienne de moi. De telles pensées me traversaient à peine lorsque j’étais vaillant et que mon cœur ne battait que pour vous ; à présent toutes mes réflexions se partagent entre vous et cette (est-ce à moi de le dire ?) ultime infirmité des esprits nobles ».
« J’ai hâte de croire en l’immortalité. Je ne serai jamais capable de vous adresser un adieu définitif. »
« Je serai aussi patient envers la maladie et aussi confiant envers l’amour que je le puis.»
… … ….
V
Je ne puis voir quelles fleurs sont à mes pieds
Ni quel subtil encens hésite sur les branches,
Mais dans l'obscurité, infuses, je devine
Les senteurs que le mois saisonnier distribue
A l'herbe, et au buisson, aux sauvages fruitiers –
L'épine blanche et l'églantine des prairies ;
Aux violettes tôt flétries enfouies sous les feuilles ;
Et à la fille aînée de mai,
La rose musquée mi-close et gorgée de rosée,
Des mouches murmurant refuge aux soirs d'été.
VI
Dans l'obscur j'écoute; et je l'ai bien souvent,
M'éprenant à demi de l'apaisante Mort,
Nommée de noms plus doux dans mes rimes rêvant,
Pour qu'elle prenne en l'air mon souffle sans effort ;
Mourir plus que jamais voluptueux me semble,
Cesser d'être à minuit sans douleur aucune
Alors que tu répands ton âme au loin
Dans une telle extase !
Tu chanterais encore, et moi l'oreille vaine –
Pour ton haut requiem je ne serais que terre.
(Ode à un rossignol. Extrait
Traduit par Fouad El – Etr)
Une nouvelle hémorragie en juin 1820. Il fait parvenir à Fanny son exemplaire de l’Enfer de Dante sur lequel est recopié le sonnet « Bright Star ».
En Août son mal empire. Il cède aux instances de son éditeur et de ses médecin qui craignent que le climat de l'Angleterre ne lui soit par trop néfaste.
« Je sens qu’il m’est presque impossible de partir en Italie ; le fait est que je ne peux vous quitter, que je ne connaîtrai le moindre instant de contentement que lorsqu’il plaira à la fortune de me laisser vivre avec vous pour de bon. Mais je ne veux continuer de la sorte. Une personne bien portante comme vous ne peut se représenter les horreurs qu’endurent des nerfs et un tempérament comme le mien… Je doute que ma santé s’améliore sensiblement tant que je serai séparé de vous. En dépit de tout cela, je suis peu disposé à vous voir ; je ne supporte plus les éclairs de lumière suivis du retour dans mes ténèbres… »
En septembre, un échange de portraits, de mèches de cheveux et de bagues scellent les adieux de Keats et de Fanny.
Joseph Severn, un ami connu alors que Keats étudiait au Guy’s Hospital l’accompagne ; hélas, le bateau sera immobilisé en quarantaine dans la baie de Naples, et Keats est tenté de mettre fin à ses jours tant l’épuisement l’accable.
Après une longue agonie, à onze heures du soir, le 23 février 1821, Keats expire dans les bras de son fidèle ami Severn.
Sur sa tombe au cimetière protestant de Rome, est gravée l’épitaphe qu’il désirait :
Here lies one whose name was writ on water.
(Ci – gît celui dont le nom fut écrit sur l’onde.)
De même il désirait que le porte – monnaie offert par sa sœur Fanny et la dernière lettre qu’il n’avait pas lue ainsi que celles de Fanny Brawne, non lues non plus, soient déposées dans son cercueil.
Shelley apprenant la disparition de Keats en sa vingt sixième année est bouleversé et compose une admirable élégie où explose la foi panthéiste de son âme.
En Août 1820, il avait offert à Keats de l’accueillir chez lui à Pise, mais sa proposition fut déclinée.
« Il vit, s'éveille - Mort, tu es morte, et non lui ;
Ne pleurez pas sur Adonaïs. – Jeune Aurore,
Fais de ta rosée· une splendeur, car celui
Sur qui tu t'affligeais, ne t'abandonne point ;
Cavernes et forêts, ne vous lamentez plus !
Ni vous, fleurs alanguies, fontaines; et toi, Air,
Qui jetais comme un voile de deuil ton écharpe
Sur notre Terre délaissée, découvre-la
Même .aux astres joyeux souriant à son désespoir.
Il n'est plus qu'un avec la Nature ; on entend
Sa voix dans toute sa musique, de la plainte
Du tonnerre, aux accents du doux chanteur des nuits ;
Il est une présence, à sentir et connaître
Dans l'ombre et la lumière, en l'herbe et le rocher,
Partout diffuse, où peut s'étendre ce Pouvoir
Qui a repris son être et le mêle au sien propre ;
Dont l'inlassable amour travaille l'univers,
Soutient ses fondements, et l'embrase par le sommet.
(Percy Shelley
Adonaïs, extrait)

Autre hommage à John Keats, le film de Jane Campion, la cinéaste néo – zélandaise qui avec « Bright Star » a renoué les fils d’une histoire dont l’essence est encore toute entière palpitante à travers la Poésie de celui qui l’incarnait dans les vers qu’il jetait à la hâte et sans effort la plupart du temps…
Brillante étoile ! que ne suis-je comme toi immuable –
Non seul dans la splendeur tout en haut de la nuit,
Observant, paupières éternelles ouvertes,
Comme de Nature le patient Ermite sans sommeil,
Les eaux mouvantes dans leur tâche rituelle
Purifier les rivages de l'homme sur la terre,
Ou fixant le nouveau léger masque jeté
De la neige sur les montagnes et les landes –
Non – mais toujours immuable, toujours inchangé,
Reposant sur le beau sein mûri de mon amour,
Sentir toujours son lent soulèvement,
Toujours en éveil dans un trouble doux,
Encore son souffle entendre, tendrement repris,
Et vivre ainsi toujours – ou défaillir dans la mort.
(Bright Star !
John Keats
Traduit par Fouad El – Etr)


Hécate.





 Le Nécrophile
Le Nécrophile « Jérôme – Hiëronimus. Dans son Jardin des Délices, Hiëronimus Bosch a peint deux jeunes hommes qui se divertissent avec des fleurs. L’un d’eux a planté de naïves corolles dans l’anus de son compagnon.
« Jérôme – Hiëronimus. Dans son Jardin des Délices, Hiëronimus Bosch a peint deux jeunes hommes qui se divertissent avec des fleurs. L’un d’eux a planté de naïves corolles dans l’anus de son compagnon.
 Le 11 octobre 1818 il fait la connaissance de Fanny Brawne dont il s’éprend. Durant les deux années de cette passion, il va lui écrire trente sept lettres, tour à tour tendres, ardentes où le tourment amoureux qui l’assaille s’exprime avec le lyrisme fervent d’une âme exigeante qui alterne avec une sincérité bouleversante qui ne sait feindre.
Le 11 octobre 1818 il fait la connaissance de Fanny Brawne dont il s’éprend. Durant les deux années de cette passion, il va lui écrire trente sept lettres, tour à tour tendres, ardentes où le tourment amoureux qui l’assaille s’exprime avec le lyrisme fervent d’une âme exigeante qui alterne avec une sincérité bouleversante qui ne sait feindre.






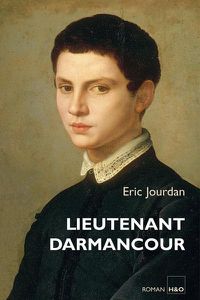




 « Il était en proie à un désir irrépressible, prendre d’assaut sa nouvelle vie. Il avait trente quatre ans et elle, à peine dix huit. Entre eux il y avait une telle différence, un écart, un abîme. Seize ans.
« Il était en proie à un désir irrépressible, prendre d’assaut sa nouvelle vie. Il avait trente quatre ans et elle, à peine dix huit. Entre eux il y avait une telle différence, un écart, un abîme. Seize ans.

 …Viens échanson, lève-toi et apporte le vin, et d’un pas magique, d’un geste où le lourd vase de cuivre ne pesait rien, le danseur ou la danseuse si léger, si légère, a rempli les verres l’un après l’autre, en commençant par celui du vizir. Michel – Ange a frissonné quand les étoffes lâches, les muscles tendus se sont approchés si près, et, lui qui ne boit jamais, il porte maintenant la coupe à ses lèvres en signe de gratitude envers ses hôtes et en hommage à la beauté de celui ou celle qui lui a servi le vin épais et épicé. Cyprès quand il est debout, c’est un saule quand, penché sur le buveur, l’échanson incline le récipient d’où jaillit le liquide noir aux reflets rouges dans la lueur des lampes, des saphir qui jouent aux rubis. »
…Viens échanson, lève-toi et apporte le vin, et d’un pas magique, d’un geste où le lourd vase de cuivre ne pesait rien, le danseur ou la danseuse si léger, si légère, a rempli les verres l’un après l’autre, en commençant par celui du vizir. Michel – Ange a frissonné quand les étoffes lâches, les muscles tendus se sont approchés si près, et, lui qui ne boit jamais, il porte maintenant la coupe à ses lèvres en signe de gratitude envers ses hôtes et en hommage à la beauté de celui ou celle qui lui a servi le vin épais et épicé. Cyprès quand il est debout, c’est un saule quand, penché sur le buveur, l’échanson incline le récipient d’où jaillit le liquide noir aux reflets rouges dans la lueur des lampes, des saphir qui jouent aux rubis. »
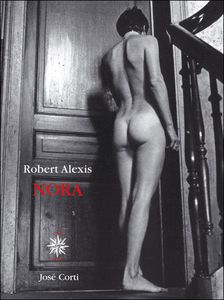


 « Coplas »
« Coplas »


